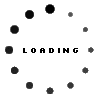Kaya a été fondé vers le XVè siècle par le Naba Sanbondo. En effet, à la demande des Marensés victimes des fréquentes attaques des peuples voisins venus du Nord, le Mogho Naaba OUBRI envoya son fils Sandbondo pour mettre fin aux razzias dont ils étaient victimes. Kaya est un canton de la principauté autonome de Boussouma.
L’ancien nom de Kaya est de l’avis général ”Sanmatenga’’ qui signifie le pays de l’or. A coté de ce nom coexistent d’autres appellations :
- Salbretenga qui signifie le lieu de fabrique des mors de cheval. On trouve des fabricants des sabliers de nos jours dans le quartier de Silmiougou et Dimassa ;
- Sanbondtenga: la terre de Sandbondo.
Le nom actuel de Kaya ou ‘’Kaye’’ en moré signifierait ‘’mil germé’’. Cette dénomination proviendrait de diverses sources. Selon une des source, lorsque le premier Européen, probablement Monteil, se présenta dans le Salmatenga, il trouva sur son chemin une femme qui faisait sécher son mil germé pour le dolo. il lui demanda le nom du village. La femme ne comprenant pas le français et croyant qu’il s’intéressait à ce qu’elle faisait repondit en moré le mot « käy » qui désignait son mil germé. (histoire courante à Kaya).
Naba Sanbondo s’est installé à son arrivée à un endroit où était étalé du mil germé. Cette aappellation ferait suite à une incompréhension entre une vieille femme et le premier colonisateur (1896 et 1901).
Les habitants auraient fuit suite à l’annonce de l’arrivée du blanc (Nassara), laissant dans la ville une vieille femme qui séchait son mil germé. Le colonisateur lui aurait demandé le nom de la ville. Celle-ci croyant qu’on lui demandait ce qu’elle séchait répondit « YA-KAYA ».
Organisation socio-politique traditionnel
Avant la colonisation, le territoire de la province du Sanmatenga actuel était occupé par :
- des populations dites autochtones composées de Ninissi, de Kibsi (Dogon) et de Yônyôosé;
- des Marensés (Sonraï) venus du Mali;
- des Nakombsé, guerriers, un peuple venu du Ghana mais surtout hommes du pouvoir venus de la région de Ouagadougou;
La vie était réglée par une organisation traditionnelle basée sur un pouvoir centralisé et hiérarchisé. Les royaumes et la principauté ont à leur tête des princes royaux appelés ‘Dima’ ou ‘Rima’, qui sont nommés comme le Mogho Naba de Ouagadougou, par un collège de dignitaires de leur principauté. Toutefois, à leur avènement, ces princes vassaux sont tenus d’informer le Mogho Naba de leur nomination et celui-ci leur donne l’investiture en leur adressant les insignes royaux.
Ils jouissent de la prérogative de nommer et de révoquer à leur guise, les chefs de canton et de village du ressort de leur principauté. Les provinces regroupent à leur tour un nombre de villages relevant de l’autorité d’un chef appelé « komboemba ».
Enfin, les cantons comprennent un certain nombre de villages relevant de l’autorité d’un chef appelé « tenga-naba » où les chefs forment un ordre aristocratique dont les membres sont unis par les liens du sang et liés au souverain par un serment de fidélité.
Il existe entre les chefs politiques mossis, une hiérarchie qui détermine les règles de préséance. Cette hiérarchie s’établit aussi bien entre les chefs de grades différents (par exemple entre chefs de cantons et chefs de villages), qu’entre chefs de grades identiques (par exemple chefs de cantons entre eux, ou chefs de villages entre eux).
A ce pouvoir politique administratif traditionnel, s’ajoute le pouvoir religieux détenu entièrement par les « nyonyoosé » qui sont également les chefs de terre.
Dans la structure de la société moaga, on distingue trois (03) composantes essentielles :
- les gens du pouvoir « naam » qui détiennent la chefferie. Plus l’on est proche du pouvoir, plus les chances de s’attribuer un commandement sont importants ;
- les gens de la terre sont représentés par les « tengen-biisi » (enfants de la terre) ayant un dignitaire (le doyen du lignage) appelé « tengsoba » (maître de la terre) qui, au niveau du village, règle les problèmes fonciers et assure toujours les fonctions religieuses d’accomplissement des rituels garantissant la productivité, la santé et la fertilité de tous les habitants du village. Il existe une grande complémentarité entre les gens du pouvoir et les gens de la terre ;
- les gens de métier regroupent diverses catégories professionnelles (les forgerons objet de discrimination notamment en ce qui concerne le mariage, les artisans-commerçants dont les plus connus sont les marensé, généralement tisserands) tous musulmans.
De plus en plus, les différences ethniques s’effacent au profit de la spécialisation socio-professionnelle.